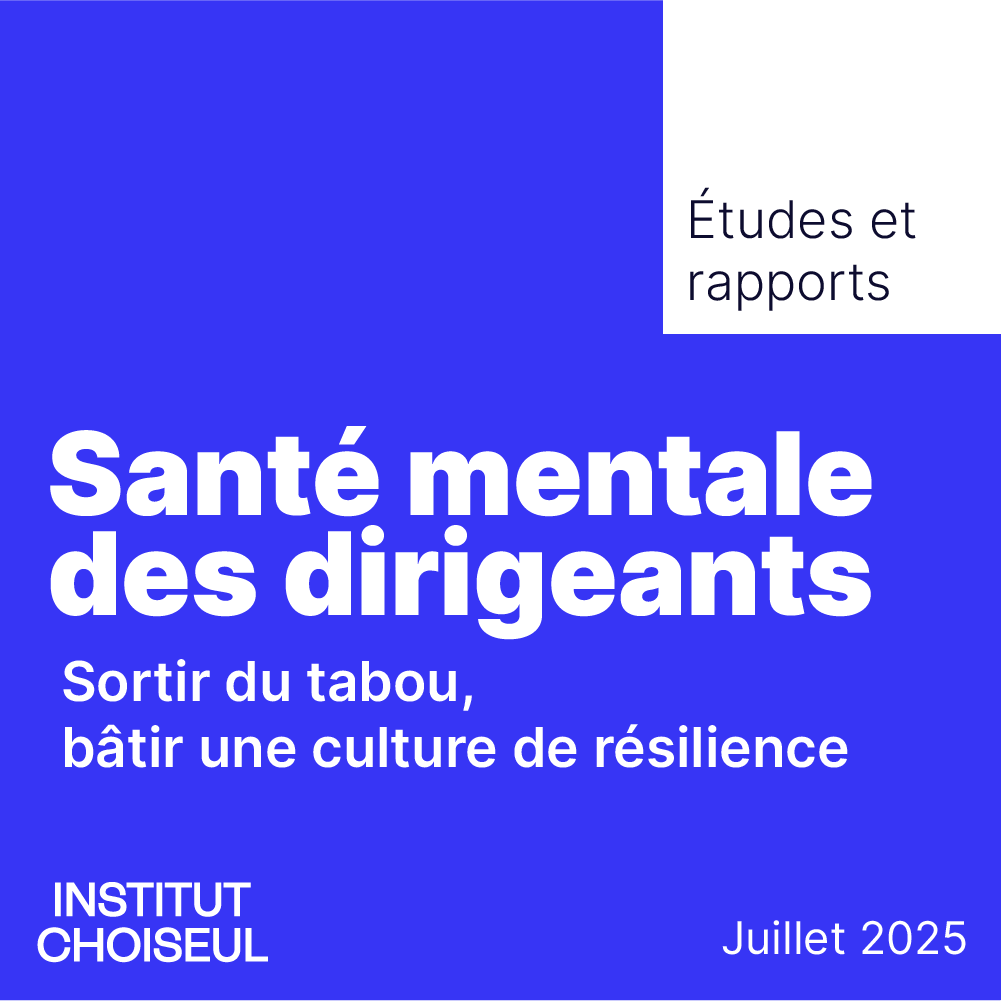
Eau et souveraineté : pour une gestion plus stratégique du premier des biens communs
Télécharger le document (pdf, 536 Ko)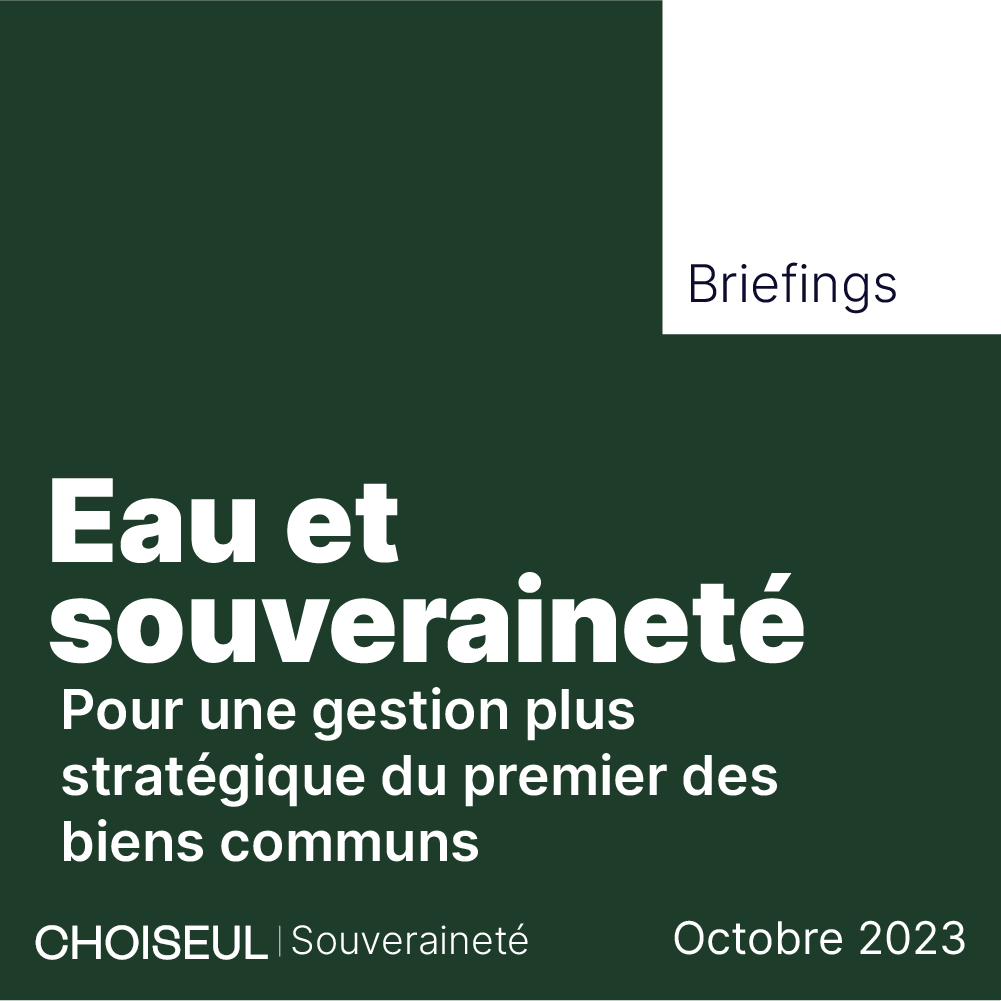
Ressource vitale, bien commun menacé, l’eau devient un enjeu de souveraineté stratégique. Alors que le dérèglement climatique en exacerbe la rareté et que la pression sur les usages s’intensifie, la France doit revoir en profondeur son modèle de gestion, d’investissement et de gouvernance pour préserver durablement sa sécurité hydrique.
Une ressource fragilisée au cœur de toutes les dépendances
La France, longtemps perçue comme privilégiée en matière de ressources hydriques, voit ses équilibres remis en question. Depuis les années 2000, les volumes d’eau disponibles ont chuté de 14 %, et les nappes phréatiques subissent une pression inédite. L’Hexagone perd jusqu’à 20 % de son eau potable dans les fuites de réseau, et jusqu’à 50 % en Outre-mer. Dans un contexte de dérèglement climatique et de récurrence des sécheresses, la soutenabilité du système actuel est remise en cause.
Les usages concurrents – agriculture, industrie, collectivités, biodiversité – créent des tensions croissantes, d’autant que les pollutions agricoles et industrielles détériorent la qualité des eaux. Face à cette situation, la gouvernance actuelle apparaît éclatée et peu lisible, répartie entre de multiples échelons (bassins, collectivités, agences).
Le « Plan Eau », lancé en 2023, constitue une première réponse structurante. Il fixe une réduction des prélèvements de 10 % d’ici 2030, encourage la réutilisation des eaux usées, et prévoit des mesures d’investissement pour moderniser les réseaux. Mais ces objectifs nécessitent un pilotage renforcé, des arbitrages clairs et une responsabilisation accrue des acteurs économiques et publics.
Repenser la gouvernance et les usages pour une souveraineté hydrique durable
La réponse à la crise de l’eau doit être systémique, au croisement des enjeux environnementaux, économiques et territoriaux. L’Institut Choiseul identifie plusieurs leviers prioritaires :
- Moderniser la gouvernance : généraliser les SAGE (schémas d’aménagement et de gestion des eaux), renforcer le rôle des agences de l’eau, créer un régulateur national inspiré de la CRE, pour piloter la stratégie à long terme.
- Financer massivement la sobriété : rattraper le sous-investissement structurel (actuellement 3 Md€ par an), favoriser une tarification progressive selon les usages, mobiliser les entreprises autour de feuilles de route sectorielles de réduction de consommation.
- Valoriser les solutions naturelles : restaurer les zones humides, déployer une hydrologie régénérative (agroforesterie, sols perméables, végétalisation urbaine), et intégrer la gestion de l’eau dans l’aménagement des territoires.
- Soutenir l’innovation : capteurs intelligents, IA pour la gestion prédictive, technologies de recyclage ou de stockage. L’écosystème français d’innovation doit être positionné comme une filière stratégique.
L’eau doit aussi être considérée comme une ressource géopolitique. À l’échelle européenne et mondiale, les tensions sur l’accès à l’eau s’intensifient. Une diplomatie de l’eau, fondée sur la coopération hydrique, la gestion transfrontalière et la régulation des usages stratégiques, devient indispensable.
L’eau, nouvel actif stratégique de notre résilience
Maîtriser notre ressource en eau, c’est préserver notre autonomie, garantir nos usages essentiels, renforcer notre cohésion territoriale. C’est aussi affirmer une ambition environnementale incarnée. La souveraineté hydrique ne peut plus être un angle mort : elle doit devenir un pilier de notre stratégie de résilience nationale.

