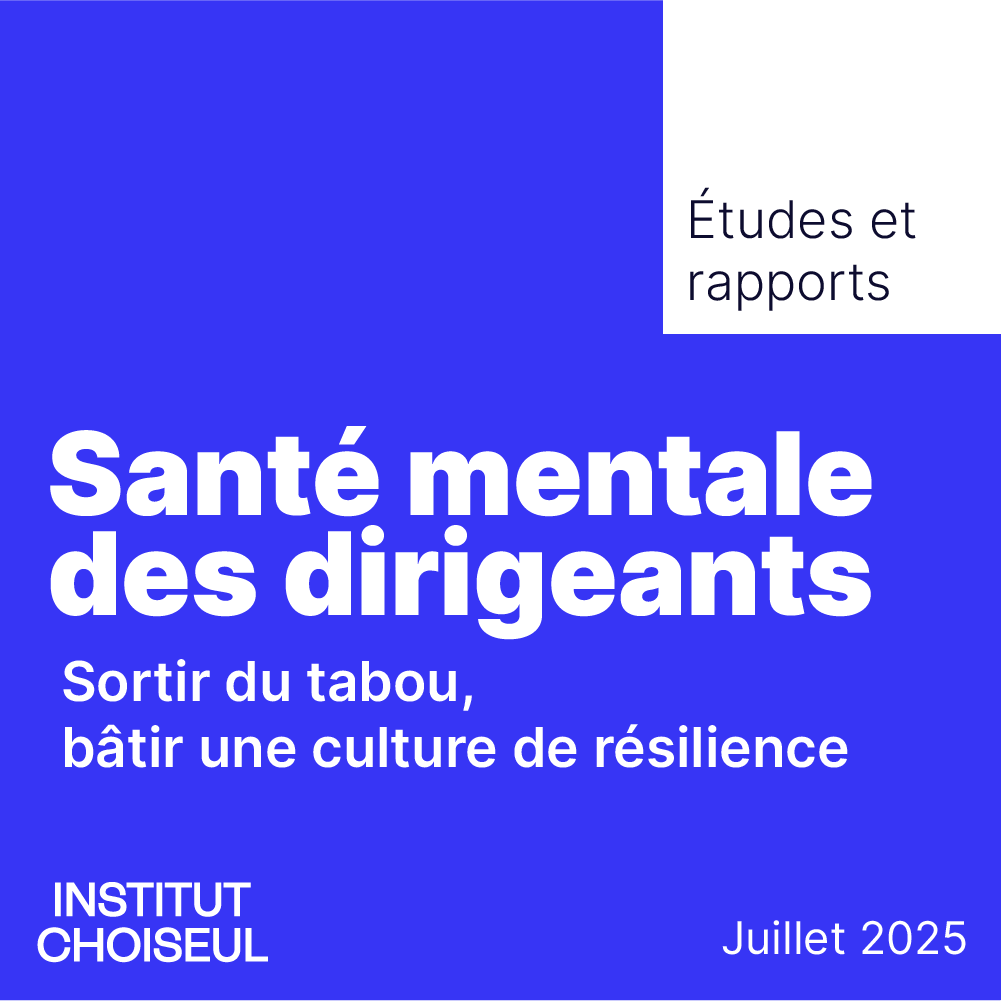
Quelles pistes pour une vraie souveraineté alimentaire ?
Télécharger le document (pdf, 774 Ko)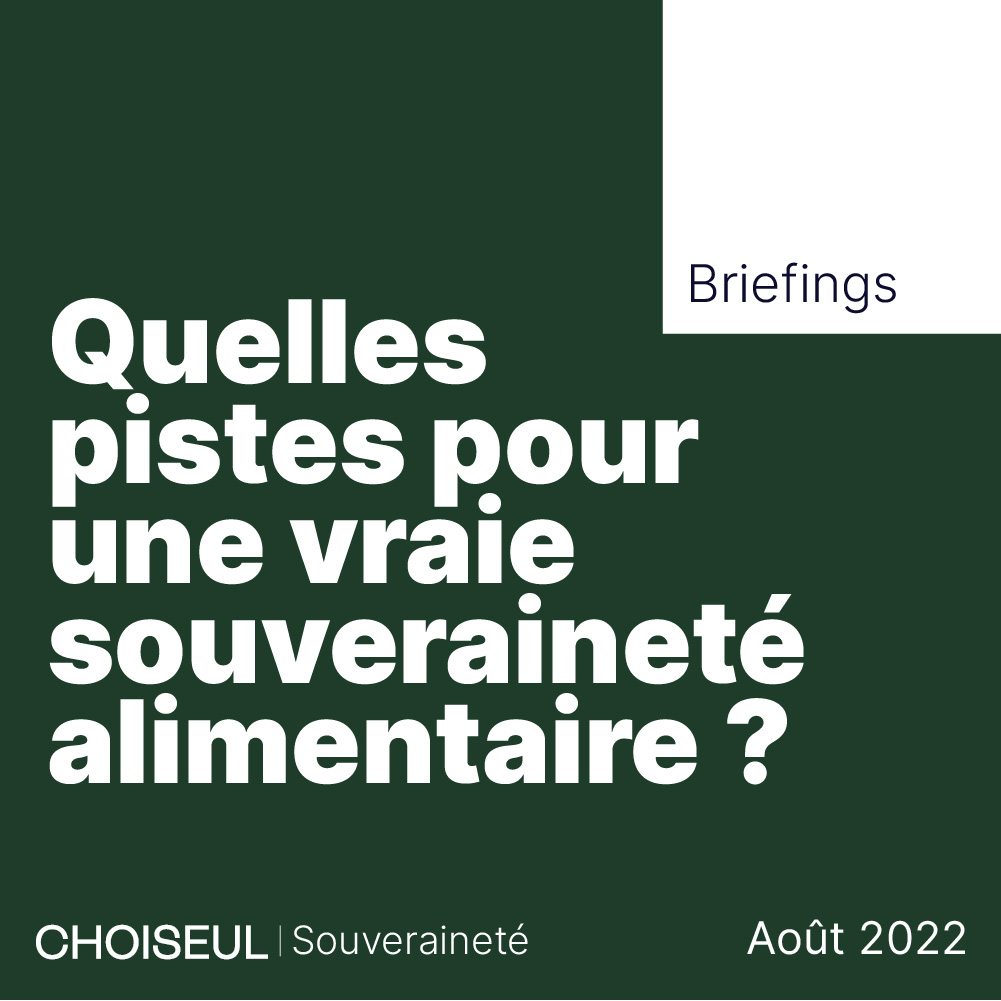
L’agriculture et l’alimentation sont redevenues des enjeux stratégiques majeurs. Face aux chocs géopolitiques, aux dérèglements climatiques et à la dépendance aux importations, la souveraineté agroalimentaire s’impose comme un impératif national et européen. Produire mieux, sécuriser les filières et défendre les savoir-faire : une triple urgence.
Une puissance agricole affaiblie par des vulnérabilités structurelles
La France reste une grande puissance agricole : première productrice de céréales de l’UE, première en valeur ajoutée agricole, et deuxième pour l’agroalimentaire transformé. Elle maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur, du champ à l’assiette, et possède des atouts logistiques, scientifiques et humains considérables.
Mais derrière ces chiffres se cachent des fragilités. Depuis 20 ans, la production de fruits et légumes recule, les protéines végétales restent massivement importées, et les dépendances aux intrants (engrais, fertilisants) exposent les filières à des risques exogènes. Plus de la moitié des fruits et légumes consommés en France sont aujourd’hui importés.
La guerre en Ukraine a révélé l’ampleur des vulnérabilités logistiques et commerciales. En quelques mois, les prix du blé, du tournesol ou du colza ont explosé. En parallèle, la dépendance européenne aux engrais russes est apparue au grand jour, fragilisant les PME agroalimentaires et accentuant les tensions inflationnistes.
Au plan structurel, l’agriculture française subit une transition démographique critique : 50 % des agriculteurs seront à la retraite d’ici 20 ans, et les installations ne compensent pas les départs. Le vieillissement des exploitants et l’augmentation des charges nuisent à la compétitivité et à la résilience des territoires ruraux.
Répondre par l’innovation, la résilience et le respect des normes
Face à ces défis, une stratégie claire se dessine : diversifier, produire, protéger. Diversifier d’abord, pour réduire la dépendance aux matières premières critiques. Cela implique de nouveaux accords commerciaux ciblés, notamment avec le Maghreb et le Canada, mais aussi d’investir dans des alternatives européennes durables, notamment via l’innovation en agrochimie et la sélection variétale.
Produire ensuite : la France doit redevenir autonome sur les protéines végétales et stabiliser ses capacités de production agricole. Le plan protéines et les investissements dans les légumineuses vont dans le bon sens. Mais la stratégie européenne « Farm to Fork » devra être réajustée pour éviter une chute de productivité estimée à -12 %.
Protéger enfin : la loi EGALIM doit être pleinement appliquée pour garantir une juste rémunération aux agriculteurs. Il faut aussi stopper la surtransposition des normes européennes, qui pénalise la compétitivité française. En parallèle, renforcer les contrôles sur les importations est indispensable : jusqu’à 25 % des produits alimentaires importés en France ne respecteraient pas nos standards sanitaires ou environnementaux.
Enfin, adapter l’agriculture au changement climatique doit devenir un objectif opérationnel. L’anticipation des chocs climatiques, la modélisation des cultures futures et la transformation des pratiques doivent structurer une nouvelle stratégie agronomique, fondée sur la recherche et la coopération européenne.
Nourrir durablement, protéger stratégiquement
La souveraineté agroalimentaire ne se décrète pas : elle se construit. Elle suppose de produire plus sans sacrifier l’environnement, de choisir ses dépendances plutôt que de les subir, et de garantir à chaque citoyen un accès durable à une alimentation saine et de qualité.
C’est aussi un enjeu de puissance, d’emploi et d’identité. Redonner à l’agriculture sa place dans le projet national et européen, c’est affirmer une vision de long terme, à la croisée de l’économie, de l’écologie et de la sécurité.

