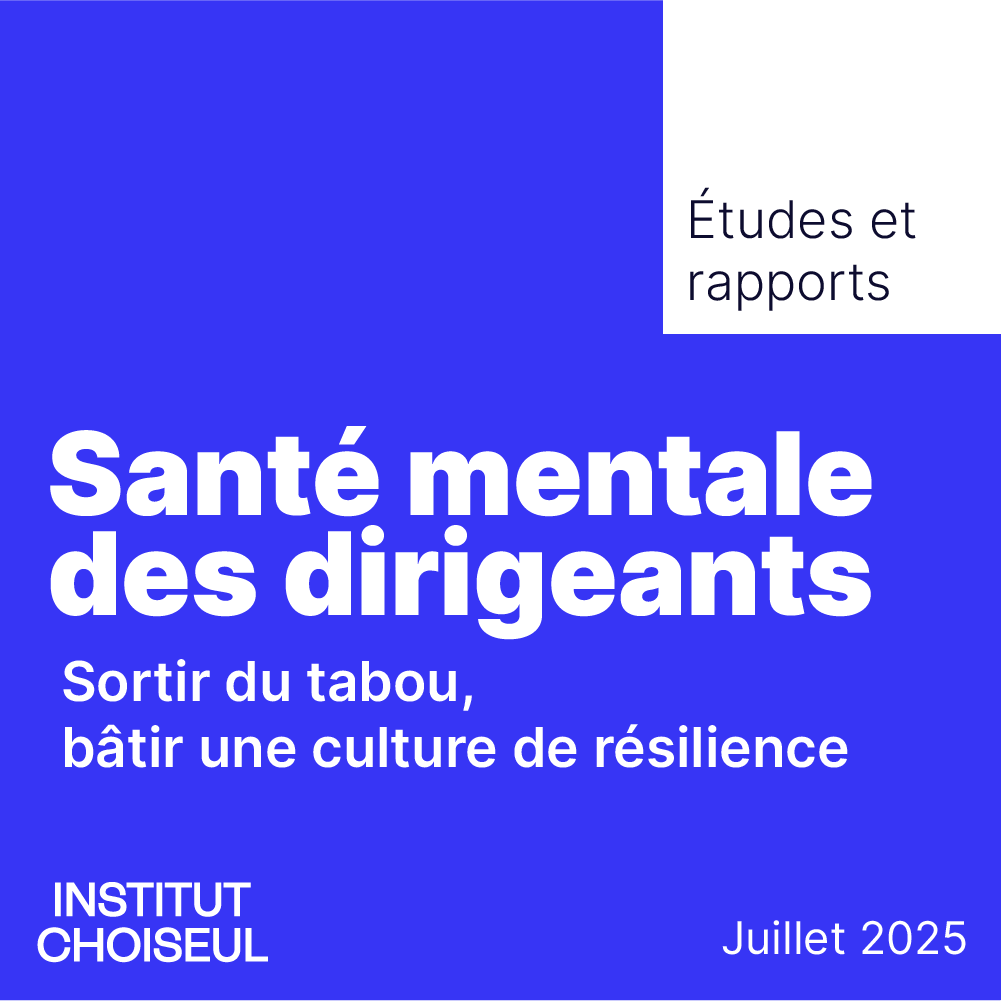
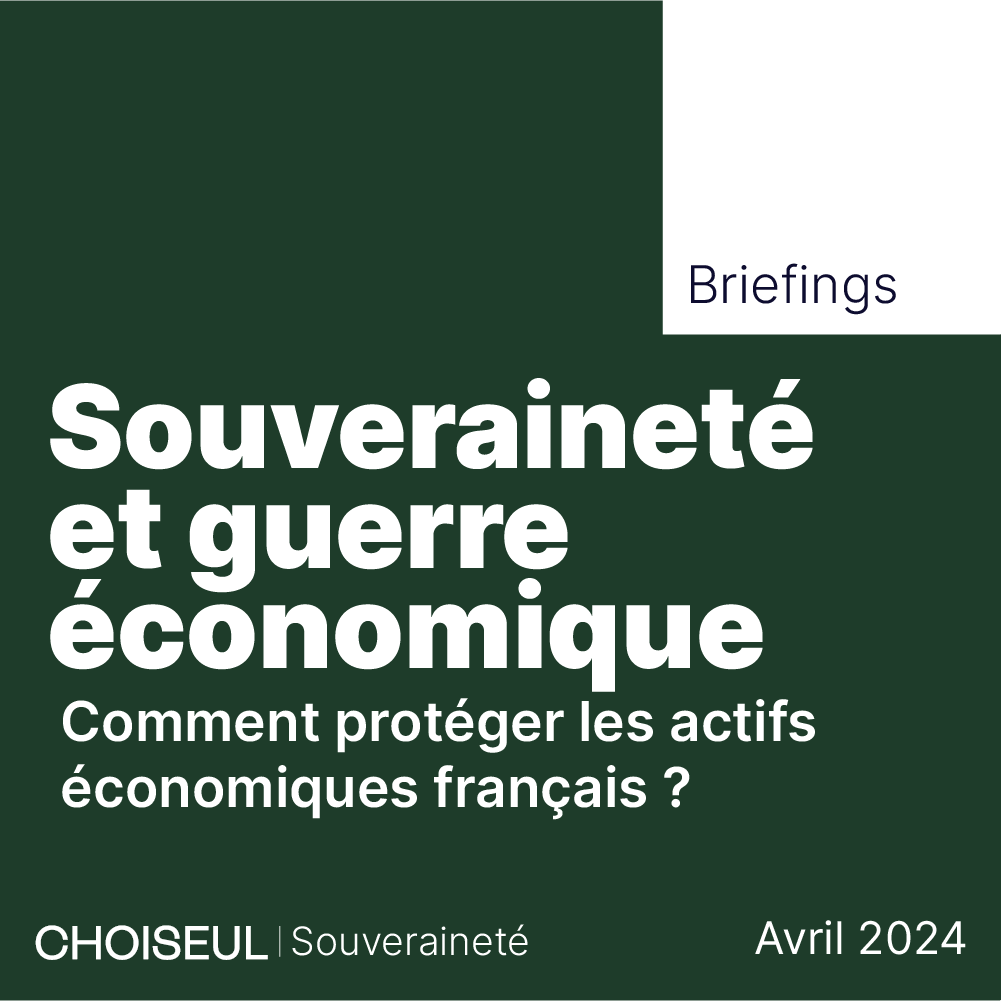
L’intensification des conflits économiques entre nations, l’essor de pratiques offensives d’influence et la multiplication des menaces hybrides sur les entreprises françaises révèlent une fragilité structurelle : la France accuse un retard en matière d’intelligence économique. Dans un contexte de recomposition géopolitique, de polycrise et d’extraterritorialité juridique, construire une stratégie offensive et coordonnée devient une priorité pour assurer la résilience économique du pays.
De la mondialisation à la guerre économique : l’évolution d’un champ de bataille invisible
Depuis les années 1970, la mondialisation a offert aux entreprises françaises un accès démultiplié à de nouveaux marchés. Mais cette ouverture géographique s’est accompagnée d’un changement de paradigme : l’espace économique est devenu un théâtre d’affrontement entre puissances. Le commerce s’est transformé en levier d’influence, les normes en armes stratégiques, et la maîtrise de l’information en clé de domination. Les chiffres sont éloquents : les entreprises françaises réalisent aujourd’hui plus de la moitié de leur chiffre d’affaires consolidé à l’étranger, accentuant leur exposition à des risques systémiques croissants.
Face à cela, la France peine à structurer une réponse d’envergure. Ni les rapports Martre (1994), Carayon (2003) ou Lemoyne-Lienemann (2023), ni les dispositifs ministériels successifs n’ont permis de construire une doctrine cohérente d’intelligence économique. En comparaison, les États-Unis disposent depuis 1977 d’un système articulé d’influence économique fondé sur l’extraterritorialité du droit (FCPA), quand la Chine appuie son ambition mondiale sur des logiques intégrées de renseignement industriel et normatif.
Résultat : la guerre économique devient un facteur tangible de perte de souveraineté. Désindustrialisation, rachats hostiles d’entreprises stratégiques, marginalisation dans les décisions internationales… entre 2003 et 2022, la part des exportations françaises dans le commerce mondial a chuté de 4,8 % à 2,5 %, pendant que celle de la Chine triplait.
Vers une doctrine française d’intelligence économique : structurer la résilience, décloisonner l’action
L’essor des menaces hybrides – cyberattaques, captation d’informations stratégiques, ingérences normatives – impose un sursaut. En 2022, la France a recensé près de 700 alertes de sécurité économique (+45 % en un an), tandis que les cyberattaques ont coûté deux milliards d’euros aux entreprises. La réponse ne peut être qu’interministérielle, publique-privée, nationale et territorialisée.
Une stratégie d’intelligence économique offensive repose d’abord sur une vision portée au plus haut niveau de l’État. Il s’agit de définir des priorités cohérentes avec les ambitions de France 2030 et la stratégie bas-carbone, de créer une structure rattachée à Matignon ou à l’Élysée, et d’instaurer un dialogue constant avec le Parlement. Sur le terrain, les régions, les CCI et les comités stratégiques de filière doivent être les relais de cette mobilisation, via des formations, des comités dédiés et une diffusion de la culture du renseignement économique.
Enfin, au niveau européen, une coordination est impérative. La bataille normative sur la taxonomie verte ou la question de l’industrie de défense l’ont montré : sans dispositif commun, les États membres risquent de s’affaiblir mutuellement face aux puissances étrangères mieux armées.
Reconquérir une souveraineté économique durable
L’intelligence économique n’est pas un luxe technocratique, mais un levier vital de résilience. Pour que la France renforce ses actifs, sécurise ses savoir-faire et défende ses positions à l’international, elle doit embrasser une culture de l’anticipation, de la coopération et de l’influence. La souveraineté économique de demain se construit aujourd’hui, dans les territoires comme dans les cénacles européens, en conjuguant lucidité stratégique et volonté politique.

